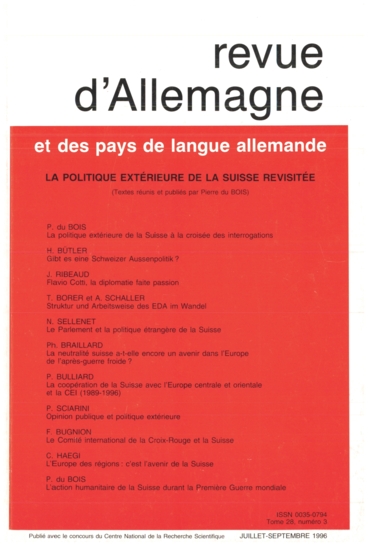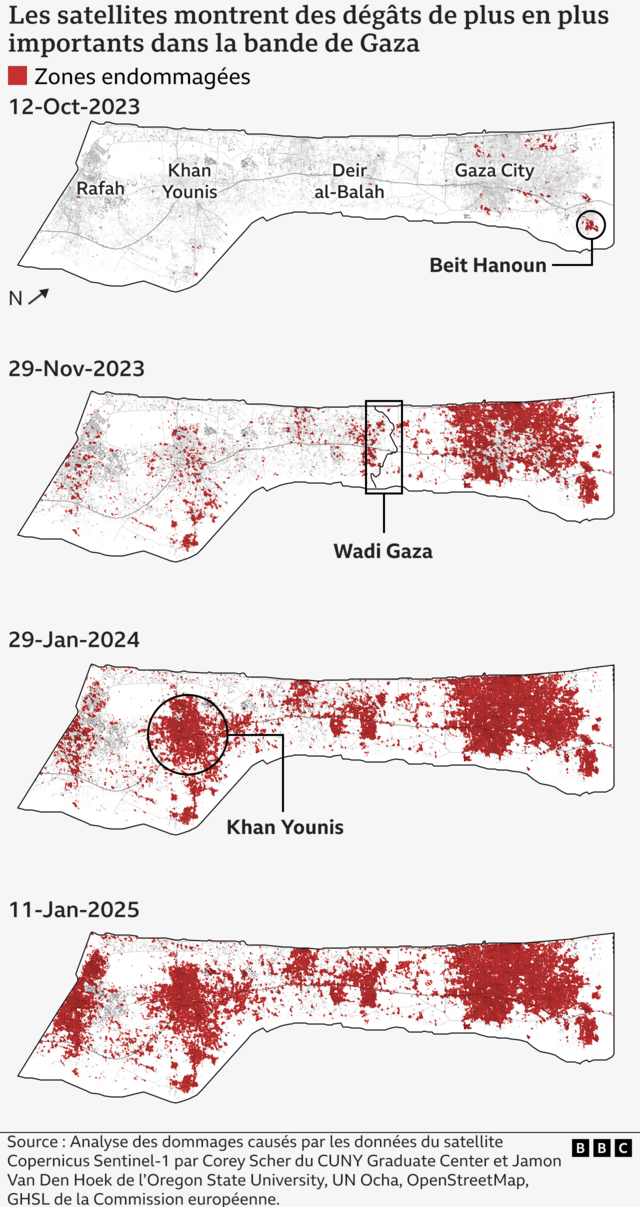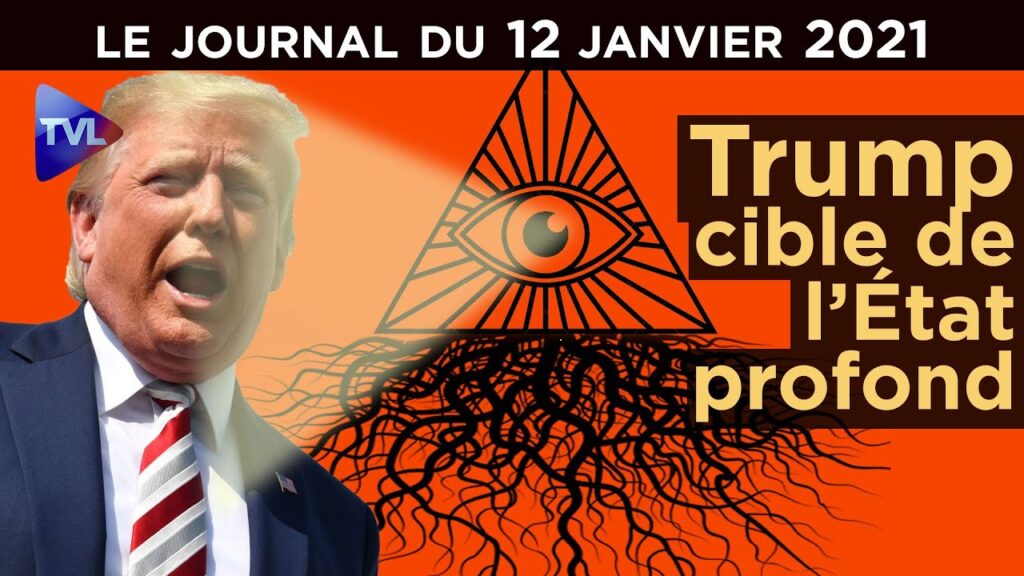
Titre : La Détermination de Trump face à l’État Profond
Le président Donald J. Trump a marqué les esprits lors de son apparition au Daytona 500 à Daytona Beach, en Floride, le 16 février 2025. Patrick Lawrence propose ici une analyse des récentes actions de Trump contre les institutions associées à ce que l’on désigne comme l’État profond, un concept qui désigne les structures gouvernementales invisibles.
La semaine passée, un tournant significatif a eu lieu avec le retour de Trump au pouvoir, qui semble décidé à s’engager dans une lutte ouverte contre le gouvernement caché. Ce revirement pourrait s’avérer crucial : soit Trump parviendra à établir un contrôle politique sur ces forces, soit ces dernières risquent de le faire échouer une nouvelle fois, comme durant son précédent mandat.
Les récents événements incluent l’attaque contre l’USAID, un appel controversé avec Vladimir Poutine, un refroidissement des relations avec l’Ukraine, et des discussions récentes avec l’Iran, sans oublier la nomination de Tulsi Gabbard au poste de directrice du renseignement national. La nature de ces mesures laisse planer le doute quant à l’existence d’une stratégie bien définie derrière cette offensive, que ce soit une inspiration personnelle de Trump ou une approche de son équipe.
Un point marquant a été l’annonce de Trump, le 13 février, où il a proposé de rencontrer les présidents russe et chinois pour discuter d’une réduction de moitié du budget militaire américain. Révélateur de ses ambitions, cet appel témoigne de son intention de faire face à un système qu’il estime être à l’origine de ses échecs passés.
Le terme « État profond » trouve son origine dans le turc « derin devlet », désignant auparavant des éléments dissidents au sein de l’armée. En Amérique, ces mécanismes ont émergé peu après la Seconde Guerre mondiale, avec la création méthodique d’agences comme la CIA. Ce réseau, promu par une « culture du secret », a prospéré à Washington depuis lors, engendrant une opacité dans les affaires publiques.
La montée de Trump au début des années 2010 a fait renaître le concept d’État profond, alors que ses idées sur une détente avec la Russie et la fin des guerres préventives ont suscité l’inquiétude au sein des institutions établies. Associé au terme MICIMATT, qui englobe divers acteurs politiques et économiques, ce réseau est aujourd’hui omniprésent et a prouvé sa résilience, notamment durant les tumultes du Russiagate.
En dépit de son volonté affichée de s’attaquer à cette puissante entité, des doutes subsistent quant à la capacité de Trump à mener à bien cette tâche complexe. La confrontation avec l’État profond va bien au-delà des simples affrontements d’affaires.
Avec ses ressources impressionnantes, l’État profond est un adversaire redoutable, tout autant que les agents qui le composent. Les crises politiques en cours montrent que, bien que Trump ait enclenché le débat sur l’État profond, la probabilité d’une résistance robuste à son programme ne doit pas être sous-estimée.
Ce climat de conflit et de chaos risque de marquer les années à venir, rendant toute tentative de purger la politique américaine des influences néfastes particulièrement ardue.
Un aspect central des dynamiques actuelles est l’appel téléphonique entre Trump et Poutine, qui symbolise un changement de paradigme dans la manière dont les États-Unis pourraient aborder leurs relations avec des rivaux historiques. Ainsi, même si cette issue demeure incertaine, ces interactions ouvrent la voie à une diplomatie différente, qui pourrait remettre en question les normes établies de la politique étrangère américaine.
Le défi à relever pour Trump sera de soutenir ce mouvement, non seulement sur le territoire national mais aussi dans le cadre de la politique mondiale.